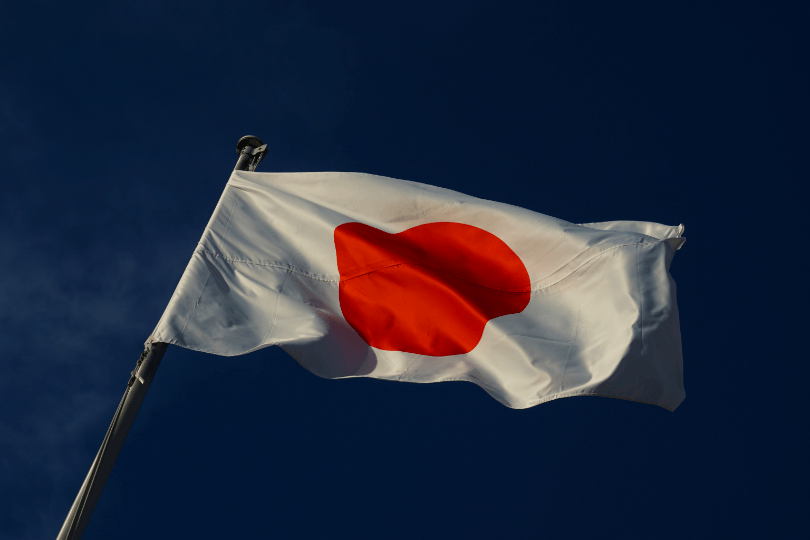Comment assurer le fonctionnement d'un régime de responsabilité élargie des producteurs : que dit le droit de la concurrence ?

AUTEUR : Romain MAULIN, Avocat en droit de la concurrence, Barreau de Paris & Laetitia GOSSELET, Avocat en droit de la concurrence, Barreau de Paris
Nul n'est censé ignorer la loi... Cela signifie que les explications juridiques doivent être connues dans le détail, surtout lorsque les instances juridiques nationales, européennes et internationales s'additionnent et que les effets de leurs décisions se combinent de plus en plus.
Dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs (REP), les producteurs peuvent choisir d'adhérer à une organisation de responsabilité des producteurs (ci-après "OPR") pour assurer la collecte et/ou le traitement et la valorisation des déchets. Ils peuvent également se regrouper au sein d'associations professionnelles comme, par exemple, le Comité français des plastiques en agriculture (ci-après "CPA"), dont la mission est d'assurer la promotion technique des plastiques en agriculture et de contribuer ainsi à l'amélioration des rendements de la production agricole.
Pas de dérogation pour la protection de l'environnement
Pourtant, les OPR, qui en droit français sont le plus souvent constituées sous forme de sociétés anonymes, sont toutes pleinement soumises aux règles du droit de la concurrence, comme l'a souligné l'Autorité française de la concurrence (ci-après "AFC")1. Cela signifie que l'OPR et chacun de ses membres sont tenus de respecter les règles du droit de la concurrence, y compris dans leurs relations avec une autorité publique2. Enfin, l'objectif légitime de protection de l'environnement que poursuit un OPR ne lui permet pas, ni à ses membres, d'échapper à ces règles. Cela signifie qu'il est demandé aux OPR de respecter pleinement notamment l'interdiction des ententes anticoncurrentielles (c'est-à-dire toutes sortes d'accords entre entreprises, de décisions d'association et de pratiques concertées qui sont susceptibles de fausser la concurrence), qui est consacrée à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après "TFUE") et à l'article L. 420-1 du code de commerce français.
En cas d'infraction...
Lorsqu'une pratique anticoncurrentielle est constatée, les autorités de concurrence peuvent imposer une amende pouvant aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise ou, dans le cas d'une OPR, 10% du chiffre d'affaires de chacun de ses membres. En outre, une entreprise ou une association d'entreprises participant à une entente : "est susceptible d'être tenue pour responsable [...] et risque de lourdes sanctions si elle contribue à la mise en œuvre d'une entente, même de manière subordonnée, accessoire ou passive, par exemple par une approbation tacite ou en omettant de signaler l'entente à la [FCA]"3.
Ainsi, la FCA rappelle explicitement que les associations professionnelles :
"jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre des procédures de concurrence, qu'elles soient consultatives ou contentieuses, ainsi que dans la formation et la sensibilisation de leurs membres aux questions de concurrence.4.
Si ces règles n'interdisent pas strictement, dans le cadre de l'OPR, tout échange d'informations entre les acteurs du marché, elles impliquent néanmoins un effort de conformité très important de la part de tous leurs membres. Cette prudence est d'autant plus importante que les informations commercialement sensibles5 est susceptible d'être échangé au sein d'un OPR lorsque les membres (i) transmettent des données sensibles (telles que des informations sur les tonnages de déchets reçus et traités et sur les tonnages de matériaux recyclés6) afin de permettre à l'OPR de calculer le montant de l'écotaxe et/ou (ii) de discuter de l'impact probable d'une réglementation envisagée.
Mettre en place des garanties ?
Il est donc essentiel que des garanties appropriées soient mises en place pour s'assurer que, comme le dit l'OCDE, les membres d'un OPR ne "utilisent pas leur coopération dans le cadre d'un OPR pour dissimuler une collusion concernant les marchés de produits".7".
La FCA a rappelé que, depuis le :
"Les organismes professionnels sont, par définition, des vecteurs de rencontres et d'échanges entre concurrents.8En effet, leurs activités, même dans le cas d'une OPR, "peuvent réduire l'autonomie des acteurs dans leur prise de décision et, par conséquent, l'incertitude qui devrait présider au fonctionnement d'un marché concurrentiel"9.
Les concurrents qui se rencontrent dans le cadre d'un OPR peuvent, par exemple, avoir un intérêt économique et une forte incitation à échanger des informations afin de : (i) répercuter une redevance ou une taxe "visible" (l'OCDE a noté qu'"un accord visant à répercuter sur les consommateurs la redevance facturée par un OP est généralement considéré comme une fixation illégale des prix. C'est le cas même si le fait de rendre une redevance "visible" est perçu comme nécessaire pour inciter les consommateurs à modifier leur comportement. Un accord visant à répercuter la redevance de l'OPR réduit le champ de la concurrence : En l'absence d'accord, les concurrents décideraient individuellement de la fraction de la redevance d'OPR qu'ils répercuteraient sur les clients"10), (ii) harmoniser l'emballage de leurs produits11 ou (iii) augmenter conjointement leurs prix.
En ce qui concerne les accords potentiels sur une redevance "visible", la Commission européenne (ci-après "la Commission") a refusé d'approuver une initiative proposée par une association d'opérateurs indépendants de réservoirs de stockage (VOTOB) qui a décidé d'augmenter ses prix d'un montant uniforme et fixe, une "redevance environnementale" pour (i) récupérer partiellement les coûts d'investissement visant à réduire les émissions de vapeur et (ii) les facturer séparément. La Commission a considéré que cette fixation éliminait la concurrence sur cet élément de prix et réduisait les incitations des membres à atteindre l'objectif au moindre coût.
Confidentialité et non-discrimination
Par conséquent, il convient d'être prudent lorsque des données sensibles sont échangées entre concurrents, au sein d'une association professionnelle ou d'un OPR, sachant que "les informations plus récentes et plus désagrégées posent davantage de problèmes"12. Des garanties juridiques appropriées doivent donc être mises en place afin de limiter les échanges aux seules données "historiques".13 et/ou des données agrégées, sachant qu'il est préférable que cette agrégation soit effectuée par un tiers indépendant.
A ce sujet, la Commission rappelle constamment que : "les échanges de données véritablement agrégées, c'est-à-dire lorsque la reconnaissance d'informations individualisées au niveau de l'entreprise est suffisamment difficile, sont beaucoup moins susceptibles d'entraîner des effets restrictifs sur la concurrence que les échanges de données au niveau de l'entreprise".
Et cela :
"La collecte et la publication de données de marché agrégées (telles que les données sur les ventes, les données sur les capacités ou les données sur les coûts des intrants et des composants) par une organisation professionnelle ou une société d'intelligence économique peuvent profiter aux fournisseurs comme aux clients en leur permettant d'obtenir une image plus claire de la situation économique d'un secteur" et, par conséquent, "de faire des choix individuels mieux informés afin d'adapter efficacement leur stratégie aux conditions du marché".
Il conclut généralement que :
"Il est peu probable que l'échange de données agrégées ait des effets restrictifs sur la concurrence".14.
La FCA indique explicitement que les OPR doivent garantir la confidentialité des informations relatives à l'activité et au fonctionnement de leurs membres et, par conséquent, ne partager avec eux que des informations entièrement agrégées.15.
Dans la même logique de respect du droit de la concurrence, il est également très important de veiller à ce que les OPR soient "ouvertes à tous les producteurs des produits qui relèvent de leur compétence"16. À cette fin, les conditions d'accès à l'OPR ne doivent pas être discriminatoires, car "si certains producteurs bénéficient de conditions avantageuses de la part d'un OPR, leurs concurrents peuvent être affaiblis, voire évincés du marché des produits"17. Toutefois, "la structure des redevances des OPR peut être discriminatoire, par exemple à l'égard des fournisseurs étrangers ou des petits fournisseurs"18.
Par conséquent, afin de limiter au maximum les risques liés au droit de la concurrence, nous vous recommandons de suivre au moins les recommandations suivantes :
¹ : AFC, avis n°12-A-17, 13 juillet 2012, §28.
² : Commission, décision n°2001/663, 15 juin 2001, §70 ; Commission, Document de la DG Concurrence concernant les questions de concurrence dans les systèmes de gestion des déchets, 22 septembre 2005, §50 : " Cela signifie que les entreprises restent responsables si l'Etat se contente d'encourager, de favoriser ou de faciliter un tel comportement ".
³ : AFC, étude thématique " Les organismes professionnels ", 27 janvier 2021, §142 ; décision n°19-D-12, 24 juin 2019, §95.
⁴ : Ibid, §73.
⁵ : En pratique, selon les circonstances, les informations commercialement sensibles peuvent inclure, sans s'y limiter, les prix, les listes de prix, les remises ou les rabais, les parts de marché, les listes de clients, les coûts de production, les quantités, le chiffre d'affaires, les stratégies commerciales, les investissements, les programmes de recherche et de développement, les stratégies commerciales, etc.
⁶ : CAF, avis n°12-A-17, op.cit, §106.
⁷ : OCDE, Responsabilité élargie des producteurs, Conseils actualisés pour une gestion efficace des déchets, 2016, p.117.
⁸ : AFC, étude thématique " Organismes professionnels ", op.cit. §133.
⁹ : Ibid, §23.
¹⁰ : OCDE, op.cit. p.145.
¹¹ : Ibid, p.149 : "Lorsque l'emballage influe sur les choix des acheteurs, l'harmonisation en matière de traitement des déchets n'implique pas nécessairement une harmonisation de la conception. L'emballage peut être plus ou moins attrayant tout en ayant les mêmes coûts de recyclage".
¹² : OCDE, op.cit. p.148.
¹³ : La Commission indique qu'" il est peu probable que l'échange de données historiques aboutisse à un résultat collusoire, car il est peu probable qu'il soit révélateur du comportement futur des concurrents ou qu'il permette une compréhension commune du marché " car " plus les données sont anciennes, moins elles seraient utiles pour détecter les écarts en temps utile et donc pour constituer une menace crédible de représailles rapides " (Commission, Lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux accords de coopération horizontale, C 11/01, 14 janvier 2011, §90). L'analyse de la jurisprudence permet de conclure que l'échange de données récentes, c'est-à-dire datant de moins d'un an, n'est pas susceptible de constituer un échange de données historiques, caractérisant ainsi un accord anticoncurrentiel (Commission, décision n°92/157, 17 février 1992, §50 ; décision n°98/4, 26 novembre 1997, §17).
¹⁴ : Commission, Lignes directrices op.cit. §89.
¹⁵ : AFC, avis n°12-A-17, op.cit. §120.
¹⁶ : OCDE, op.cit. p.117.
¹⁷ : OCDE, op.cit. p.149.
¹⁸ : Ibid.
¹⁹ : L'ACP a adopté des lignes directrices concurrentielles avec des choses à faire et à ne pas faire.
[/mepr-show]